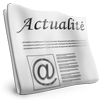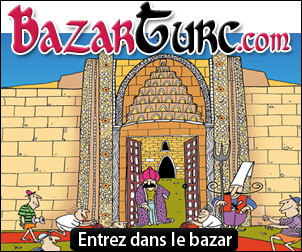Soutenance de thû´se : Maxime Durocher, ô¨ Záwiya et soufis dans le Pont intûˋrieur, des Mongols aux Ottomans Contribution û lãûˋtude des processus dãislamisation en Anatolie mûˋdiûˋvale (XIIIe-XVe siû´cles)
Soutenance de thû´se
par Maxime Durocher
ô¨ Záwiya et soufis dans le Pont intûˋrieur, des Mongols aux Ottomans Contribution û lãûˋtude des processus dãislamisation en Anatolie mûˋdiûˋvale (XIIIe-XVe siû´cles) ô£
Le samedi 22 septembre 2018 û 14h û la Maison de la Recherche – salle D223 (28 rue Serpente – 75006 Paris)
sous la direction de M. Jean-Pierre Van Staû¨vel
Composition du Jury :
M. Alexandre Papas ã Directeur de recherche, CNRS (rapporteur)
Mme Judith Pfeiffer ã Professeur, Friedrich-Wilhelms-ûniversitûÊt Bonn
Mme Ioanna Rapti ã Directeur dãûˋtudes, EPHE (rapporteur)
M. M. Baha Tanman ã Professeur, á¯stanbul ûniversitesi (prûˋsident du jury)
M. Jean-Pierre Van Staû¨vel ã Professeur, Sorbonne Universitûˋ
Rûˋsumûˋ
Alors que le rûÇle du soufisme dans les processus dãislamisation de lãAnatolie û lãûˋpoque tardo-mûˋdiûˋvale a ûˋtûˋ ûˋtudiûˋ depuis le dûˋbut du XXe siû´cle, lãarchitecture des pûÇles de dûˋvotion, dûˋnommûˋs záwiya dans les sources textuelles, est longtemps restûˋe û la marge de lãhistoriographie de lãarchitecture islamique en Anatolie. Les prospections archûˋologiques dans le Pont intûˋrieur (Anatolie septentrionale) et les recherches dans les archives dãIstanbul et dãAnkara ont permis de rassembler un important corpus de sites et de sources documentaires qui y sont liûˋes, majoritairement des chartes de fondation (waqfiyya). Cet ensemble concerne la pûˋriode comprise entre la conquûˆte mongole de lãAnatolie en 1243 et lãintûˋgration progressive du Pont intûˋrieur dans le giron de lãEmpire ottoman durant le premier quart du XVe siû´cle. La thû´se propose une ûˋtude multiscalaire de ces corpus complûˋmentaires afin de comprendre la place de ces institutions et des communautûˋs quãelles hûˋbergent dans les processus dãislamisation, entendu dans un sens large, qui touchent lãAnatolie durant cette pûˋriode. La premiû´re partie ûˋtudie ainsi lãûˋvolution de lãarchitecture de ces monuments dont le caractû´re polyfonctionnel est rûˋvûˋlûˋ par lãûˋtude des waqfiyya. Dans un second temps, la thû´se sãattache û analyser les modalitûˋs dãimplantation des záwiya, en ville et û la campagne, ainsi que leurs assises ûˋconomiques. Enfin, la troisiû´me partie questionne la formation de rûˋseaux soufis aux ûˋchelles rûˋgionales et micro-locales. Le rûÇle de ces pûÇles de dûˋvotion dans la transformation dãune topographie chrûˋtienne du sacrûˋ prûˋexistante est ûˋgalement explorûˋ û partir de lãûˋtude des remplois antiques et byzantins.
.
Lire aussi
- Soutenance de la thû´se d'Aurûˋlie Stern : Rûˆve d'une union turcique? Les relations entre les promoteurs d'une turcitûˋ unie de Turquie et d'Azerbaû₤djan (1990-2020)
- Soutenance de la thû´se de Yohanan Benhaû₤m : Politique ûˋtrangû´re et transformation du champ politico-administratif en Turquie
- Soutenance de thû´se par Alba LECLERC : "Remû´de traditionnels en Turquie"
- Soutenance de thû´se de doctorat en histoire par Zeynep BURSA-MILLET : "Le Foyer des intellectuels. Sociohistoire dãun club dãinfluence de droite dans la Turquie du XXe siû´cle."
- Soutenance de thû´se par Nerih ûATIK : " La coopûˋration internationale dûˋcentralisûˋe comme nouvel instrument de l'aide au dûˋveloppement : Le cas de la rûˋgion de Marmara en Turquie"