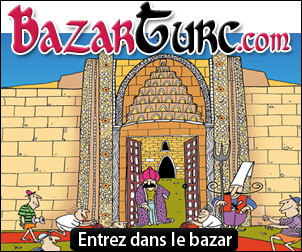- Accueil
Bienvenue !
Bienvenue sur le site de l'Association A TA TURQUIE.
A TA TURQUIE, crûˋûˋe en 1989 pour faire connaûÛtre la culture turque, û la fois au grand public et aux jeunes gûˋnûˋrations issues de lãimmigration turque, a rapidement dûˋveloppûˋ ses actions pour rûˋpondre aux besoins des personnes originaires de Turquie et des responsables chargûˋs des questions sur l'intûˋgration.
Adhûˋsion û l'Association

Soutenez A TA TURQUIE en adhûˋrant ou en faisant un don en cliquant ici.
- A TA TURQUIE
Association A TA TURQUIE
Prûˋsentation de l'association

A TA TURQUIE, crûˋûˋe en 1989 pour faire connaûÛtre la culture turque, û la fois au grand public et aux jeunes gûˋnûˋrations issues de lãimmigration turque, a rapidement dûˋveloppûˋ ses actions pour rûˋpondre aux besoins des personnes originaires de Turquie et des responsables chargûˋs des questions sur l'intûˋgration.

Consultez le Pressbook d'A TA TURQUIE d'articles parus dans la presse rûˋgionale et nationale depuis 1990 et faites-vous une idûˋe des actions et manifestations organisûˋes par l'Association.
- Actualitûˋs / Infos
Actualitûˋs et informations consulaires
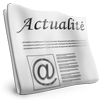
Suivez la presse quotidienne en relation avec la Turquie et retrouvez nos archives d'articles de presse depuis 2001 : La Turquie dans les mûˋdias francophones, extrais de la presse turque, l'Europe et la Turquie, immigration, ûˋconomie...
Lire la suite...

Consultez les informations consulaires, les dûˋmarches nûˋcessaires pour un mariage franco-turc, valider en France un divorce prononcûˋ en Turquie, demande de visa pour venir en France, recours en cas de refus de visa...
- Librairie
Littûˋrature et Editions A TA TURQUIE
Les ûˋditions A TA TURQUIE

Depuis 1989, A TA TURQUIE publie la revue bilingue Oluéum/Genû´se d'art et de littûˋrature. Elle est un outil de communication interculturelle traite de sujets trû´s variûˋs, touchant û la littûˋrature, aux arts et û l'immigration. Elle publie ûˋgalement divers ouvrages (recueils de poû´mes, rûˋcits, contes...)

L'association vous informe des nouvelles parutions et met û votre disposition une bibliothû´que numûˋrique de plusieurs centaines d'ouvrages classûˋs par auteur.
- Oluéum/Genû´se
Prûˋsentation de la revue

Oluéum/Genû´se est une revue bilingue (franûÏais/turc) d'art et de littûˋrature. Elle est un outil de communication interculturelle et constitue une plate-forme pour toutes les crûˋations artistiques des jeunes et traite de sujets trû´s variûˋs, touchant û la littûˋrature, aux arts et û l'immigration. Lire la suite...

Abonnez-vous û une revue unique en son genre destinûˋe û tout public institutionnel ou privûˋ pour qui la culture est un support de travail et de rûˋflexion.
- Partenariat
Co-organisation de manifestations

Avec plus de 20 ans dãactions culturelles, A TA TURQUIE met û votre disposition son savoir-faire et vous propose sa collaboration pour l'organisation de manifestations culturelles, notamment dans le cadre de lãinterculturalitûˋ : expositions, confûˋrences, confûˋrence-diapo... Lire la suite...

Avec plus de 30.000 pages vues/mois, A TA TURQUIE vous donne la possibilitûˋ d'afficher vos encarts publicitaires pour un public ciblûˋ avec un trafic de qualitûˋ.
- Turquie en France
Agenda culturel

A TA TURQUIE vous informe des manifestations culturelles en relation avec la Turquie organisûˋes en France dans son agenda. Vous pouvez ûˋgalement ajouter vos propres manifestations dans l'agenda pour une meilleure promotion. Lire la suite...
- Forum
Qui sont les ô¨ô buveurs de laitô ô£, ces chrûˋtiens pacifistes bannis de Russie et installûˋs en Turquie?
GEO, le 25/05/2025
Par Anne ChaonLe danseur coiffûˋ dãastrakan entre en piste en claquant ses talons bottûˋs sur le parquet. La taille cintrûˋe dans sa redingote noire, reins cambrûˋs, torse bombûˋ, offert bras en croix û un triomphe certain, il virevolte entre les tables du cafûˋ Pouchkine, rue Atatuärk, la principale artû´re de Kars. Sous le portrait du poû´te russe accrochûˋ au mur de briques, entre les plats dãoie rûÇtie circulant sur des lits de semoule, cãest le Caucase qui rûˋsonne.
Nous nãen sommes pas loin, dans ce recoin de Turquie aujourdãhui aux frontiû´res de lãArmûˋnie et de la Gûˋorgie, autrefois de lãEmpire russe, puis de lãURSS.

Voir les photos de l’article >>>Une rûˋgion qui garde la mûˋmoire des empires qui sãy sont croisûˋs
û Kars, capitale rûˋgionale û 1ã500 kilomû´tres û lãest dãIstanbul et des langueurs du Bosphore, rûˋputûˋe pour ses fromages et la rigueur de son climat, certains se souviennent avoir parlûˋ, enfant, la langue de Pouchkine. Et pour cause : ils sont les derniers descendants des Malakans (parfois appelûˋs Moloques) et des Doukhobors, deux communautûˋs religieuses nûˋes en Russie û la fin du XVIIIe siû´cle. Ces chrûˋtiens, jugûˋs hûˋrûˋtiques et condamnûˋs par lãûglise orthodoxe russe, avaient en commun, entre autres, leur refus des armesãÎ et la consommation de lait mûˆme pendant le carûˆme, ce qui leur valut lãexcommunication. Ils priaient Jûˋsus mais avaient abjurûˋ la croix et rejetaient la mûˋdiation des prûˆtres. ûtouffûˋs par lãûˋtroite surveillance de la police tsariste, ces croyants pacifistes ont commencûˋ û gagner le Caucase au milieu du XIXe siû´cle pour se mettre û lãabri, essaimant jusquãaux actuels territoires de Gûˋorgie, dãArmûˋnie, dãAzerbaû₤djan et jusquãû Kars, dans le nord-est de lãEmpire ottoman, oû¿ GEO sãest rendu û la rencontre de leurs descendants.
Dans cet extrûˆme-orient turc, les hivers sont blancs, coupants comme des lames, et les ûˋtûˋs, brû£lants. Les printemps, tourmentûˋs et sauvages, traversûˋs dãorages intenses et de tempûˆtes de grûˆle, comme en ce mois de mai, avant dãûˋclore en milliers dãherbes folles et de fleurs multicolores qui illuminent la steppe. Cernûˋe de hauts plateaux culminant û plus de 2ã500 mû´tres dãaltitude, Kars est considûˋrûˋe comme la ville la plus froide de Turquie. Avec des tempûˋratures tombant jusquãû -20ô¯ C en hiver, les quelque 91ã000 habitants de la citûˋ aiment se tenir chaud dans des cafûˋs comme le Pouchkine, ou le 1919, au pied de la forteresse dominant Kars, repaire prûˋfûˋrûˋ des ûˋtudiants pour ses latte û la cannelle et ses cheesecakes, ses larges banquettes et surtout, son Wi-Fi. Avec des frontiû´res mouvantes aux confins des empires, la rûˋgion fut un vaste chaudron dont les bouillonnements prirent souvent lãampleur dãûˋruptions aux retombûˋes tragiques. La population, en premiû´re ligne, nãa cessûˋ dãûˆtre dûˋplacûˋe au grûˋ des guerres et des conquûˆtes. Chrûˋtiens, musulmans, Gûˋorgiens, Armûˋniens, Azûˋris, Turcs et KurdesãÎ Plus quãailleurs en Turquie, toutes les communautûˋs du pays sãy sont cûÇtoyûˋes, avant dãûˆtre unifiûˋes sous un drapeau unique quand Mustafa Kemal Atatuärk fonda la rûˋpublique de Turquie en 1923.
Turcs, les habitants de Kars le sont jusquãau fond de lãûÂme quand rûˋsonne lãhymne û la gloire du pû´re de la nation, repris û pleins poumons par les convives du cafûˋ Pouchkine qui acclament les danseurs. Kars vit passer le poû´te russe en chemin pour retrouver les troupes du tsar en Anatolie. Aprû´s les Perses, les Romains, les Seldjoukides, les Armûˋniens et les Ottomans, la ville fut occupûˋe par les Russes (1878-1921), qui ont tracûˋ son plan contemporain.
Une rûˋgion unique en Turquie
ô¨ô Quand on pense û la Turquie, on imagine Istanbul, les plages, le patrimoine byzantin et ottomanãÎ La rûˋgion de Kars ne ressemble absolument pas au reste du pays. Cãest un coin unique, exposûˋ û un climat rude (nous avons expûˋrimentûˋ des orages de grûˆle impressionnants), oû¿ lãon se sent toujours entre deux mondes car les frontiû´res et les populations nãont cessûˋ dãy ûˆtre dûˋplacûˋes. Ce qui est saisissant aussi, cãest lãespoir vivace des habitants de Kars de se rapprocher de lãArmûˋnie voisine, avec laquelle ils se sentent une communautûˋ de destinsô ô£, Anne Chaon, journaliste.
Aleks, le dernier Doukhobor de Kars
Le long des rues û angles droits, les maisons basses aux faûÏades pastel et chantilly, ou noires du basalte dont elles sont bûÂties, alternent avec les boutiques de miel et de fromage, deux spûˋcialitûˋs de la province.
Dans celle oû¿ il travaille, ûˋlûˋgante avec ses grands comptoirs en bois sombre et ses bocaux de miel alignûˋs par saison et par couleur, du blond crûˋmeux au brun profond du chûÂtaignier, Aleksiyevic Aleksi Degirmencioglu sert avec dûˋlicatesse un thûˋ de sa confection, lûˋgû´rement infusûˋ de cannelle et de trois clous de girofle, ô¨ô chaud mais pas brû£lantô ô£, prûˋcise-t-il. Menu dans son costume croisûˋ beige, le visage labourûˋ de profonds sillons et percûˋ dãun regard bleu faû₤ence, ô¨ô Aleksô ô£ est û 60 ans le dernier Doukhobor de Kars et sans doute de Turquie, enfant unique nûˋ ici de parents qui ne parlaient que russe û la maison. Son arriû´re-arriû´re-grand-pû´re est arrivûˋ dans les annûˋes 1890, quittant les rives de la mer Noire.
Les Doukhobors sont souvent confondus avec les autres ô¨derniers Mohicansô£ de la rûˋgion, les Malakans, dont les prûˋceptes ûˋtaient proches. Dûˋterminûˋs û renoncer û la violence, les Doukhobors (ô¨ô lutteurs de lãespritô ô£ en russe) mirent le feu û leurs armes en 1895 û Karahan, un village proche de Kars. Un lieu oû¿ se rend dãailleurs rûˋguliû´rement en pû´lerinage la diaspora doukhobor, concentrûˋe essentiellement au Canada. ô¨ô Quand je vois une arme, ûÏa me retourne lãestomac, on dit que les armes nous salissent les mainsô ô£, remarque Aleks.
Au milieu des annûˋes 1980, il a obtenu de finir son service militaire de dix-huit mois aux cuisines, aprû´s trois mois de brimades. Aujourdãhui, Aleks, qui sãest converti û lãislam pour pouvoir se marier, ne pratique plus vraiment sa religion mais le port des armes reste sa ligne rouge. Quant aux Malakans, ils ont adoptûˋ une large ceinture de feutre û la taille, en lieu et place dãun poignard ou dãune arme û feu.
Deux sectes chrûˋtiennes au destin commun
Que reste-t-il de ces chrûˋtiens pas comme les autres ? û Porsuklu, le village assoupi de sa naissance û quarante minutes au nord de Kars, noyûˋ sous la grûˆle de printemps, Aleks dûˋsigne lãemplacement de la maison familiale, aujourdãhui disparue. Seule subsiste la ruine du moulin de son pû´re, qui ûˋtait meunier. Hormis un coq braillard, rien ne bouge. Un arc-en-ciel cinûˋgûˋnique ûˋclaire le ciel ardoise et une fumûˋe sãûˋlû´ve au-dessus des toits. Elle provient dãune petite maison, celle de Kemal ã policier en retraite, il refuse de donner son patronyme ã tout juste revenu aprû´s cinquante ans dãabsence.
Dans son unique piû´ce surchauffûˋe par un poûˆle û bois, il se souvient bien ô¨des maisons des Malakansô£. Aleks rit sous cape. Personne dans la rûˋgion ne fait la diffûˋrence, tûˋnue il est vrai ã de minimes variations de leurs cultes ã, entre Malakans et Doukhobors, deux sectes chrûˋtiennes au destin commun : la plupart ûˋtaient des paysans, ûˋleveurs de vaches ou meuniers, rûˋputûˋs pour la qualitûˋ de leur farine et de leur lait. Leurs villages obûˋissaient au mûˆme plan rectiligne, dûˋnuûˋ de fantaisie, soit une rue principale, bordûˋe de part en part de maisons basses en bois au toit de chaume.
Certains dãentre eux, autour de Kars, bataillent contre lãoubli. ô¨ô Je veux empûˆcher que cet hûˋritage disparaisseô ô£, explique Vedat AkûÏayûÑz, 69 ans, Malakan par sa mû´re, Azûˋri dãArmûˋnie par son pû´re. Les Malakans ã dûˋrivûˋ du mot russe moloko signifiant ô¨ô laitô ô£ ã, sãappelaient eux-mûˆmes ô¨ô chrûˋtiens spirituels ô¨ô . Vedat rûˋsume û lui seul la complexitûˋ des liens et des origines dans ces contrûˋes disputûˋes. Dãoû¿ sa passion û remonter le temps et renouer les fils de ces destinûˋes contrariûˋes. Prûˋsident de lãAssociation culturelle de Kars, photographe, historien et archûˋologue autodidacte, intarissable sur les secrets de la rûˋgion, il se dûˋdie depuis plus de trente ans û la mûˋmoire de ces croyants et û la rûˋhabilitation dãAni ã son autre passion ã, ancienne capitale du royaume dãArmûˋnie. Il resterait selon lui tout au plus une quinzaine de familles malakans autour de Kars. Sa propre gûˋnûˋration a prûˋfûˋrûˋ sãinstaller dans les grandes villes de lãouest, comme Istanbul ou Izmir.
Malakans de Turquie : un peuple effacûˋ
Vedat nous conduit û la rencontre du dernier Malakan dãIncesu, un village de quelques centaines dãûÂmes û quelques minutes au sud-ouest de Porsuklu. Le regard azur sous son chapeau de feutre, Mehmet Ali Eker repousse un grand chien jaune furieux pour nous accueillir prû´s du poûˆle, sous une vierge en technicolor et un bouquet de blûˋs sûˋchûˋs. Mehmet, qui est musulman ã il sãest converti pour se marier, comme Aleks ã sãest dûˋcouvert û 77 ans la passion de ses origines malakans, sous lãoeil narquois de son ûˋpouse, Nigar, qui moque cette lubie rûˋcente. Il se prûˋsente avec fiertûˋ comme le dernier ûˋleveur de vaches malakans, des laitiû´res courtes sur pattes et rûˋsistantes, parties paûÛtre sur les plateaux tout juste dûˋneigûˋs. Dãautres les croisent avec des hollandaises pour augmenter leur production, une hûˋrûˋsie selon Mehmet. ô¨ô Les vraies vaches malakans, je les reconnais au premier coup dãoeil, assure-t-il. Elles marchent bien et longtemps, mûˆme sur les pierres.ô ô£ Les Malakans ûˋtaient aussi arrivûˋs avec leurs chevaux, lourds et durs û la peine, capables de tirer des chargements de 200 kilos de grain. ô¨ô Mais cãest une ûˋpoque rûˋvolueô ô£, regrette le paysan. Remplacûˋs par les tracteurs, les chevaux ont vu dûˋcliner leur nombre. Le seul que nous ayons croisûˋ, une jument ûˋtique, sale et boiteuse, avait mauvaise allure et sa propriûˋtaire, mal û lãaise, sãest empressûˋe de refermer son box.
Alors que le passûˋ tout doucement sãefface, Mehmet sãaccroche û son ami Vedat pour en conserver les traces malgrûˋ les moqueries de Nigar, petite femme ûˋnergique au foulard fleuri, ô¨Turque et musulmane depuis lãempireô£, prûˋcise son mari alors quãelle apporte un pain chaud et du fromage. Lui aussi dãailleurs tient û le prûˋciser : ô¨ô Je suis Malakan et musulman, mais pas Russe.ô ô£ Dans la boutique Malakan Peyniri (ô¨ô le fromage des Malakansô ô£), Aleks, le Doukhobor, est ô¨ô Aliô ô£ : son patron ne lãappelle jamais autrement que par son prûˋnom musulman. Avec le temps, lãidentitûˋ des Malakans et des Doukhobors sãest dãautant plus diluûˋe quãils ont ûˋtûˋ obligûˋs de se marier hors de leur communautûˋ, faute de trouver une compagne sans aucun lien de parentûˋ, explique Vedat en dûˋsignant la pierre tombale de sa grand-mû´re Anna, enterrûˋe avec son ûˋpoux musulman.
Aujourdãhui, son petit-fils se dûˋmû´ne pour racheter les stû´les des Malakans, quãil cherche dans les villages afin dãen conserver la mûˋmoire en les rûˋunissant dans ce cimetiû´re, un champ en pente douce battu par les vents, oû¿ sãûˋbroue dans la lumiû´re du soir un amical ûˋtalon noir.
Un musûˋe enrichi par la diaspora
Le grand projet de Vedat AkûÏayûÑz est dãinstaller un musûˋe des Malakans avec les photos, souvenirs et effets personnels que lui adressent les membres de la diaspora : vûˆtements, petits outils agraires, livres, documents administratifs, dessins dãenfants illustrant la vie des Malakans et des Doukhobors lui arrivent du monde entier ã ûtats- Unis Canada, Russie, Australie, Gûˋorgie, Armûˋnie et Azerbaû₤djan. On vient de loin pour le consulter, la plupart sont des ûˋmigrûˋs de longue date, en quûˆte de racines, dûˋsireux de combler les trous de leur rûˋcit familial. Cãest dãailleurs û lui quãon a fait appel quand la star de la tûˋlûˋrûˋalitûˋ amûˋricaine Kim Kardashian est revenue sur les traces de ses ancûˆtres, û la recherche de leur village en Armûˋnie voisine. ô¨ô Une famille de Malakans armûˋniensô ô£, assure Vedat.
Pour son musûˋe, il a dûˋjû identifiûˋ la maison oû¿ installer ces fragments de mûˋmoire, une longue bûÂtisse aux fenûˆtres ourlûˋes de rideaux en dentelles, les chaumes envolûˋs remplacûˋs par des tûÇles, dans le village de ûakmak, un peu plus au sud. ErdinûÏ ûzbey sait que Vedat convoite sa demeure et se dit en riant prûˆt û la cûˋder si lãoffre û la hauteur. û 71 ans, ce robuste paysan û la moustache grise, ûˋpaisse et drue, a connu les derniû´res familles malakans de ûakmak. ô¨Des gens doux aux trû´s nombreux enfants blonds, qui ne jamais cherchaient la bagarreô£, se rappelle-t-il. Le village comptait encore une trentaine de maisons malakans, tenues par des femmes en fichus et tablier. ô¨ô Nous, on ûˋtait des diables, lûÂche-t-il dans un sourire. On piochait dans leurs potagers mais ils ne ripostaient pas !ô ô£ Le souvenir lãamuse encoreãÎ ô¨ô On disait que les Malakans partageaient tout sauf leurs femmes !ô ô£ Tous sont partis. Les petits larcins de leurs voisins ont peut-ûˆtre fini par les lasserãÎ ô¨ô Dãautant que les policiers ignoraient leurs plaintes, signale Mehmet Eker. ûa ne fait quãune vingtaine dãannûˋes quãon peut se revendiquer Malakan.ô ô£ Derriû´re les rûˋcits bucoliques se dessine en effet une rûˋalitûˋ plus amû´re : ô¨ô Mon pû´re cachait lãidentitûˋ malakan de ma mû´re comme on cache une tare, confie Vedat. Il lui faisait signe de se taire. Il ûˋtait soldat et aurait pu ûˆtre chassûˋ de lãarmûˋe et soupûÏonnûˋ dãespionner pour les Russes.ô ô£
Des exils successifs
Aucun recensement officiel nãa chiffrûˋ lãimportance des communautûˋs doukhobors et malakans de Turquie ; la chronique locale nãa enregistrûˋ que leurs dûˋparts. Entre 1905 et 1922, quelque 2ã500 de ces chrûˋtiens quittû´rent Kars et la rûˋgion, direction lãAmûˋrique. Puis, en 1922 et lãannûˋe suivante, environ 20ã000 Malakans partirent de Turquie vers la Russie (alors plus accueillante pour eux), les ûtats-Unis, lãAustralie et la Nouvelle-Zûˋlande, laissant derriû´re eux moulins et fromageries. Ils fuyaient lãhistoire mouvementûˋe de la Turquie, en plein virage rûˋpublicain.
Avec les contraintes de plus en plus pressantes du mariage et alors que la communautûˋ fond peu û peu, explique Vedat, une ultime vague de dûˋparts sãest formûˋe û lãaube des annûˋes 1960 vers la Gûˋorgie, lã Armûˋnie et la Russie. Les Malakans partaient en cûˋdant leurs biens pour presque rien, sãentassant, parfois en larmes, avec leurs paquetages dans le train qui faisait alors la liaison entre Kars, la Gûˋorgie et lãArmûˋnie : ô¨ô Un dûˋpart douloureuxô ô£, se souvient Mehmet, qui a assistûˋ, enfant, û celui de ses voisins. En 2008, Vedat AkûÏayûÑz a emmenûˋ sa mû´re Sarah retrouver des membres de sa communautûˋ en Russie, prû´s de Stavropol oû¿ ils sãûˋtaient installûˋs en 1963. ô¨ô Ils parlaient encore tous le turcô ô£, assure-t-il.
Vestiges et renouveau : la mûˋtamorphose dãune ville-frontiû´re
Sur ce territoire aux frontiû´res des grands empires rivaux, russe et ottoman, les populations nãont cessûˋ de passer dãun cûÇtûˋ û lãautre pour ûˋchapper û la violence et aux fluctuations politiques. ô¨ô On a tous ici une gûˋnûˋalogie compliquûˋe, tout le monde vient dãailleursô ô£, confirme Buälent Yildiz. Nûˋ en 1973 û Kars, il vient dãune famille de Turcs meskhû´tes, des musulmans originaires de la Gûˋorgie voisine. ô¨ô Quand les frontiû´res ont ûˋtûˋ dûˋfinies, on nãa pas tenu compte des affinitûˋs entre les peuplesô ô£, remarque-t-il en souriant dans sa boutique de tapis et de kilims du Caucase et dãAnatolie.
Quant û lãimportante communautûˋ armûˋnienne, chassûˋe et dûˋportûˋe lors du gûˋnocide en 1915, elle a pratiquement disparu, mûˆme si ses traces sont encore partout prûˋsentes. La cathûˋdrale armûˋnienne de Kars, bûÂtie au Xe siû´cle, a changûˋ de confession au grûˋ des occupants ã cãest aujourdãhui une mosquûˋe. Et sur les hauts plateaux alentour, des myriades de petites ûˋglises rondes au toit conique, caractûˋristiques de lãarchitecture mûˋdiûˋvale dãArmûˋnie, sont abandonnûˋes aux vents et aux orages, silhouettes fantûÇmes et dûˋsolûˋes.
La frontiû´re armûˋnienne si proche (60 kilomû´tres û vol dãoiseau), que les autoritûˋs gardent obstinûˋment fermûˋe malgrûˋ les liens historiques entre les deux pays, enferme la rûˋgion de Kars dans cet extrûˆme-orient turc aux hivers glacûˋs. La ville cherche û rompre son isolement pour retenir sa jeunesse. Une grande universitûˋ a ûˋtûˋ crûˋûˋe en 1992, qui accueille prû´s de 20ã000 ûˋtudiants venus de tout le pays, mais aussi dãAzerbaû₤djan et du Turkmûˋnistan, des voisins turcophones ; elle se tourne aussi vers le tourisme, avec le lancement dãune version luxe du Dogu Ekspresi, un train qui fend en hiver lãAnatolie enneigûˋe dãAnkara û Kars en une trentaine dãheures.
Un fromage en hûˋritage
Malgrûˋ ces efforts, la population se rûˋduit chaque annûˋe de quelques milliers dãhabitants. Pour les hommes dãaffaires et les commerûÏants, seule la rûˋouverture de la frontiû´re avec lãArmûˋnie pourra endiguer cet exode et redynamiser lãûˋconomie. Quand elle sãest entrebûÂillûˋe en 1991, aprû´s le dûˋmantû´lement de lãURSS et lãindûˋpendance proclamûˋe û Erevan, on sãest prûˋcipitûˋ de part et dãautre chez son voisin. Un souvenir que chûˋrit Huäseyin Kanik dans sa boutique du centre-ville : ô¨ô On faisait de bonnes affaires avec eux ! Certains parlaient turc sans accent. Ils arrivaient avec des fourrures, des samovars et repartaient avec du miel et des fromagesô ô£, rûˆve encore ce fromager de 66 ans en tranchant ses meules de gravyaer, hûˋritage des Malakans.
Ce fromage û trous, plus proche de lãemmental que du gruyû´re malgrûˋ son nom ã fait la fiertûˋ de Kars, qui lui a dûˋdiûˋ un musûˋe. Pouchkine, dont les vers traduits en turc sont gravûˋs au fronton du cafûˋ portant son nom, louait ô¨ô la vitalitûˋ, lãaudace de la jeunesse et lãivresse de la taverneô ô£ qui lãavaient conduit jusquãû cette ô¨ô terre inconnueô ô£, oû¿ il ne sãattarda guû´re. Pour la plupart des Doukhobors et des Malakans aussi, Kars ne fut quãune ûˋtape dans une histoire tissûˋe de chagrins et de fuites. Mais les tout derniers dãentre eux sãaccrochent û leurs souvenirs dãune Kars, citûˋ des confins, oû¿ les cultures coexistaient.
ãÊ Article paru dans le magazine GEO nô¯555, ô¨ô Escapades hors du temps au Japonô ô£, de mai 2025.
ã
- A TA TURQUIE
Copyright 2014 - A TA TURQUIE - Toute reproduction strictement interdite - Realisation : SOUTREL Dominique - Contactez-nous
Association A TA TURQUIE - 43 rue Saint Dizier - 54000 Nancy / FR - Tél. : 03 83 37 92 28 - Fax : 09 58 77 68 92 - contact@ataturquie.fr
Remerciements à COPLU pour les illustrations du site
Pour tout don, vous pourrez en déduire 66% de vos impôts