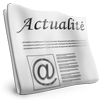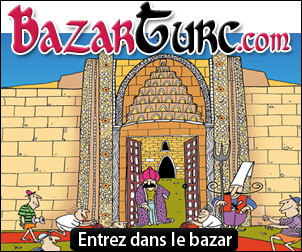Il a 17 ans, la vie devant lui et le sourire de ceux qui retrouvent un vent de fra├«cheur apr├©s de longues semaines de labeur. Ey├╝p (son nom a ├®t├® modifi├®) est carrossier, il habite ├Ā Istanbul avec sa m├©re et sŌĆÖenvole tous les deux ou trois mois pour le sud du pays. Pouces crois├®s sur le ventre, chapelet de pri├©re en main et calotte blanche sur la t├¬te, il ressemble ├Ā sŌĆÖy m├®prendre aux dizaines dŌĆÖautres hommes, jeunes et moins jeunes, assis dans lŌĆÖavion, ce matin dŌĆÖoctobre, en direction de la ville dŌĆÖAdiyaman.
Comme eux, Ey├╝p fait partie des quelques centaines de fid├©les, parfois m├¬me des milliers, ├Ā venir ainsi de toute la Turquie, chaque fin de semaine, dans cette cit├® grise et sans attrait. Par groupes, ils montent ensuite dans des navettes en direction du village de Menzil, si├©ge spirituel de leur confr├®rie religieuse, situ├® ├Ā une quarantaine de minutes de lŌĆÖa├®roport. Le trajet se fait entre gens de connivence, qui chantent et prient ├Ā haute voix.
Ultraconservatrice, nationaliste aussi, consid├®r├®e, dans les ann├®es 2000, comme le principal vivier de recrutement de lŌĆÖorganisation Etat islamique dans le pays, la r├®gion est aujourdŌĆÖhui le point de passage oblig├® des adeptes de la secte Menzil. Celle-ci est devenue, ces derni├©res ann├®es, une des deux ou trois plus puissantes organisations islamiques du pays, qui en compte une centaine, voire le double, selon certaines sources.
Personne ne conna├«t le nombre exact de fid├©les de ces ordres mystiques dŌĆÖinspiration soufie, les tariqas (pour ┬½ voie menant ├Ā Dieu ┬╗), comme on les appelle, organis├®s autour de la figure charismatique de cheikhs auxquels les membres doivent ob├®issance. Mais tout le monde sait en Turquie quŌĆÖils constituent un maillage consid├®rable de la soci├®t├® civile, jusque dans les cercles les plus restreints du pouvoir.
Un ┬½ ├óge dŌĆÖor ┬╗
A vrai dire, ils sont partout et nulle part, le plus souvent discrets, m├¬me sŌĆÖils ont parfois pignon sur rue. Leurs fortunes diverses sont sujettes ├Ā sp├®culation. Pas une semaine ne sŌĆÖ├®coule sans un titre de presse consacr├® ├Ā une confr├®rie, o├╣ se m├¬lent histoires de succession, de gestion de biens, dŌĆÖ┼ōuvres caritatives, de fondations, dŌĆÖh├┤pitaux, dŌĆÖ├®coles, de foyers, de contrats publics, de cha├«nes de t├®l├®vision ou dŌĆÖune n├®buleuse dŌĆÖassociations.
La plupart du temps, les journaux dŌĆÖopposition au pouvoir islamo-conservateur du pr├®sident Recep Tayyip Erdogan et du Parti de la justice et du d├®veloppement (AKP), en place depuis 2002, accusent les autorit├®s dŌĆÖun soutien, ├Ā tout le moins dŌĆÖune complaisance de plus en plus ├®vidente, ├Ā leur ├®gard.
Indice r├®v├®lateur, plus de 200 articles consacr├®s aux tariqas ont ├®t├® censur├®s en 2023. Signe de lŌĆÖint├®r├¬t que ce sujet suscite. Il est vrai que certains sp├®cialistes, non sans le critiquer, estiment m├¬me que les confr├®ries vivent un v├®ritable ┬½ ├óge dŌĆÖor ┬╗. CŌĆÖest ce quŌĆÖ├®crit le journaliste Ismail Ari, dans un ouvrage, MenzilŌĆÖin Kasasi (┬½ Le butin de Menzil ┬╗, ├®ditions Tekin, non traduit), publi├® en septembre et aussit├┤t menac├® de saisie. Un appel est en cours. Le livre dresse une forme dŌĆÖinventaire des biens et soci├®t├®s li├®s ├Ā la confr├®rie qui fait plus penser ├Ā une holding quŌĆÖ├Ā une association spirituelle ├Ā vocation caritative.
A lŌĆÖinstar des membres dŌĆÖautres confr├®ries, les menzils se sont largement int├®gr├®s au fonctionnement capitaliste de lŌĆÖ├®conomie, au point de sŌĆÖ├®loigner de principes religieux de base, tels que la ┬½ taqwa ┬╗ (sŌĆÖabstenir des affaires du monde au nom dŌĆÖAllah), comme lŌĆÖa d├®crit lŌĆÖanthropologue et sp├®cialiste des confr├®ries, Tayfun Atay.
Ey├╝p, lui, se fiche ├®perdument de ce que lŌĆÖon raconte. Ce quŌĆÖil aime le plus au monde, cŌĆÖest la foi en Dieu, sa confr├®rie et la superbe de son village. Il sŌĆÖy sent bien, et veut le faire savoir. Lui-m├¬me nŌĆÖ├®tait pas n├® lorsque le cheikh Abdulhakim Erol, premier chef spirituel de Menzil, rach├©te, en 1971, ce hameau perdu ├Ā la lisi├©re des champs appel├® ┬½ Durak ┬╗, o├╣ vivaient ├Ā peine entre quinze et vingt familles. DŌĆÖun trait de plume, le nom changea. Depuis, assure le jeune disciple, ┬½ plusieurs millions de personnes, comme [lui], se sont rendues ici ┬╗.
┬½ CŌĆÖest la charia ┬╗
Le village compte aujourdŌĆÖhui pr├©s de 3 000 habitants. A lŌĆÖapproche de celui-ci, le paysage change, la route devient impeccable. Les champs, taill├®s et tir├®s au cordeau, donnent lŌĆÖimpression dŌĆÖune petite Suisse anatolienne. A Menzil, la rue principale est goudronn├®e avec soin, le carrefour dot├® de feux de signalisation. Des fid├©les sont l├Ā pour vous orienter. Encore quelques sup├®rettes, un restaurant de burgers locaux, des r├®sidences de plusieurs ├®tages et surtout deux immenses mosqu├®es avec leurs d├®pendances, somptueuses et clinquantes, un grand r├®fectoire o├╣ les rations de soupe sont gratuites et partag├®es en groupe, des magasins, un grand cimeti├©re et des mausol├®es.
Ici, on prie cinq fois par jour, comme ailleurs, mais deux fois plus longtemps. A la fin du service, certains hommes r├®p├©tent et invoquent, crescendo, le nom de Dieu. Les femmes, elles, sont s├®par├®es et restent derri├©re un long mur. Dans le village, elles sont rares, voil├®es de noir quand on les croise. ┬½ CŌĆÖest la charia, dit Ey├╝p, enfin celle que nous voulons pour la Turquie, adapt├®e ├Ā notre pays, comme Dieu le veut. ┬╗
Plus quŌĆÖun p├©lerinage, le village de Menzil est un lieu central de recueillement et dŌĆÖexpiation des p├®ch├®s pour les fid├©les. Un lieu saint parmi les saints depuis que la secte a gravi, pas ├Ā pas, les ├®chelons de la notori├®t├®. ┬½ Nous voulons que tout le pays vive comme nous ┬╗, d├®clare le jeune homme, avec une assurance d├®sarmante, r├®v├®latrice de lŌĆÖimpressionnant pouvoir dŌĆÖattraction de ces ordres mystiques et du chemin parcouru par les confr├®ries dans cette Turquie cens├®e ├¬tre la├»que. A la mort, en 2023, dŌĆÖAbdulbaki Elh├╝seyni, fils du fondateur et troisi├©me cheikh de la lign├®e, le pr├®sident ne lŌĆÖa-t-il pas pr├®sent├® comme ┬½ lŌĆÖun des guides spirituels du pays ┬╗ ?
Conqu├¬te de lŌĆÖespace public
Voies mystiques de lŌĆÖislam, originaires dŌĆÖAsie centrale et de Perse, jouant un r├┤le-cl├® entre les d├®cideurs et le peuple dans le fa├¦onnement du paysage spirituel anatolien, les tariqas et leurs loges ont ├®t├® d├®mantel├®es en 1925 par le fondateur de la R├®publique, Mustafa Kemal, dit Atat├╝rk (1881-1938). LŌĆÖinterdiction contraint alors de nombreux ordres ├Ā la clandestinit├®, certains continuant toutefois dŌĆÖexister de mani├©re informelle, tant lŌĆÖattrait des Turcs pour la sociabilit├® confr├®rique reste fort. Les pratiques soufies, en particulier celles qui sont associ├®es aux ordres mevlevi et naqshbandi, se maintiennent en vie ├Ā travers de petites communaut├®s souvent familiales. Menzil est lŌĆÖune des formations de la Khalidi, une branche de cette confr├®rie Naqshbandi.
Il faut attendre la fin des ann├®es 1950 pour que les ordres mystiques connaissent un regain dŌĆÖint├®r├¬t, en particulier apr├©s lŌĆÖassouplissement de certaines politiques la├»ques. Turgut ├¢zal (1927-1993), le pr├®sident qui ouvre la Turquie ├Ā lŌĆÖ├®conomie lib├®rale entre 1989 et 1993, a ├®t├® membre, un temps, de la tariqa Iskenderpasa. Necmettin Erbakan (1926-2011), p├©re de la droite islamiste turque et premier ministre entre 1996 et 1997, sŌĆÖen est rapproch├®, tout comme le jeune Recep Tayyip Erdogan. Rest├®e tr├©s implant├®e dans le quartier stambouliote de Fatih, Iskenderpasa est d├®crite par certains experts comme la mieux repr├®sent├®e au sein du gouvernement, en cette fin des ann├®es 1980-d├®but des ann├®es 1990.